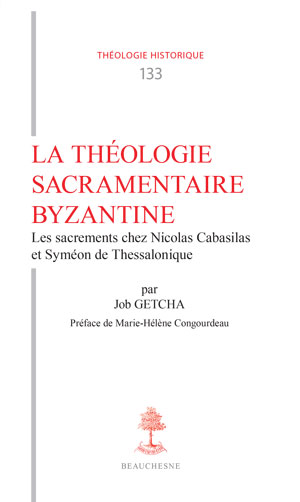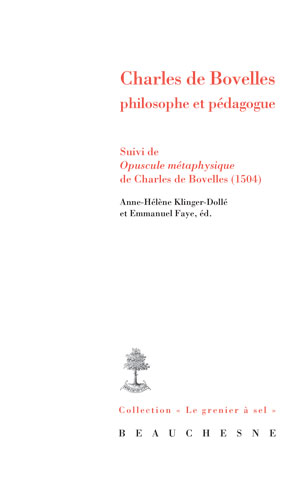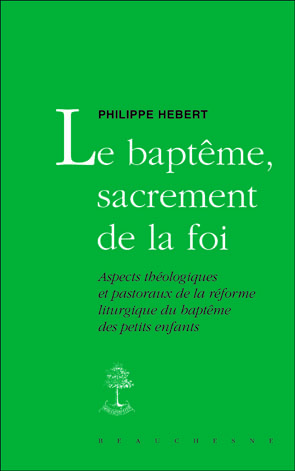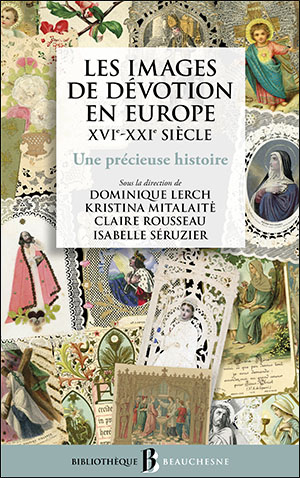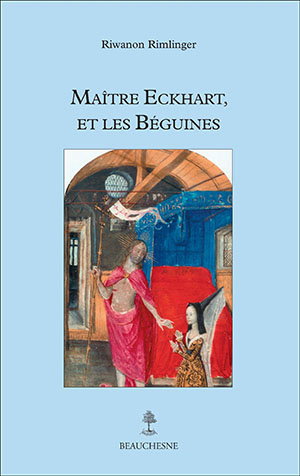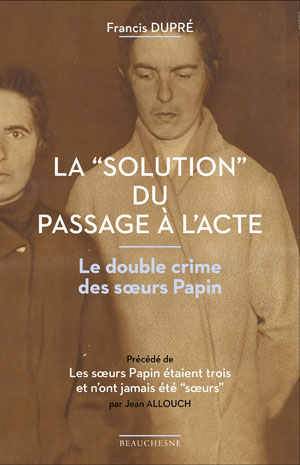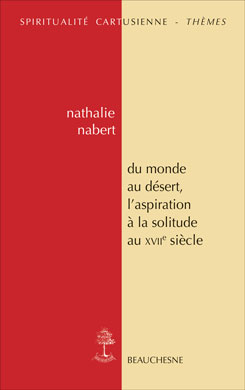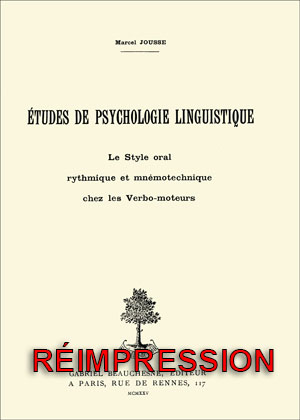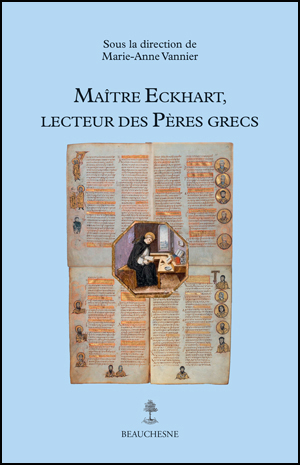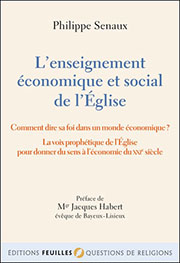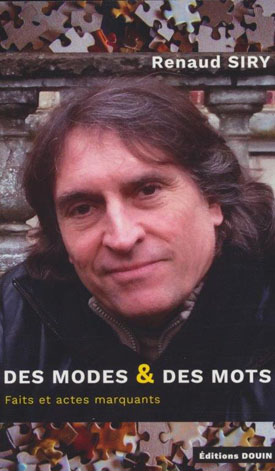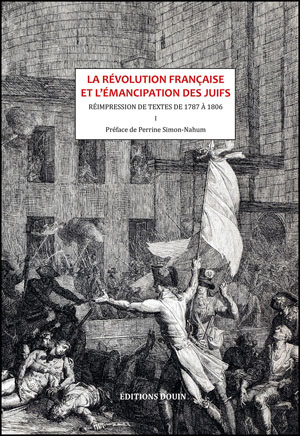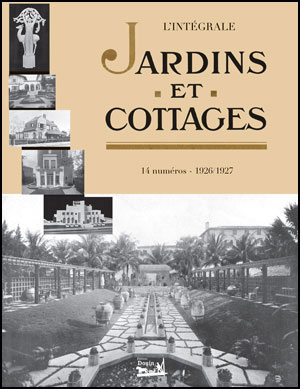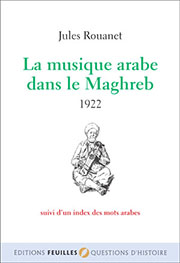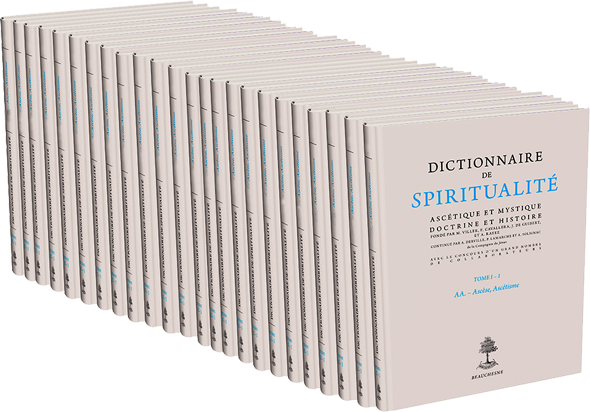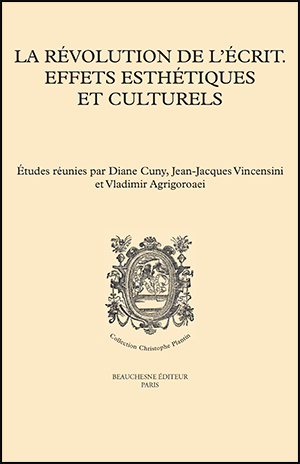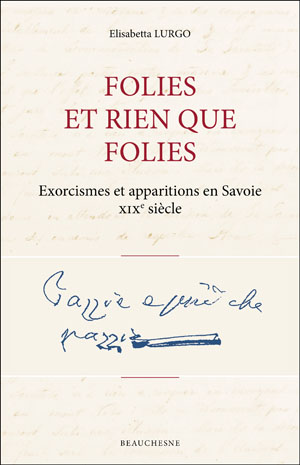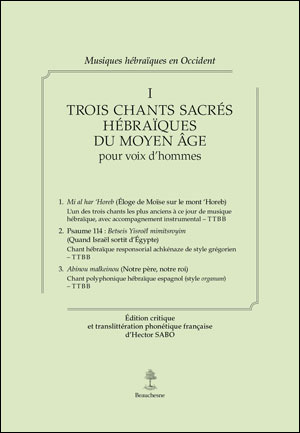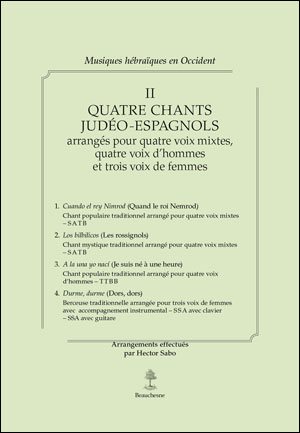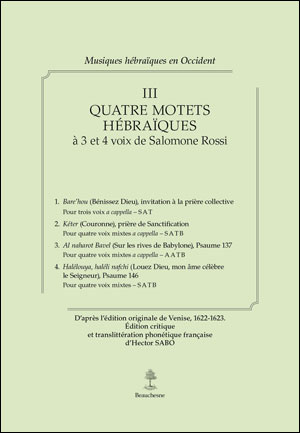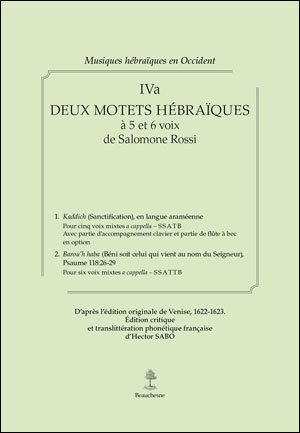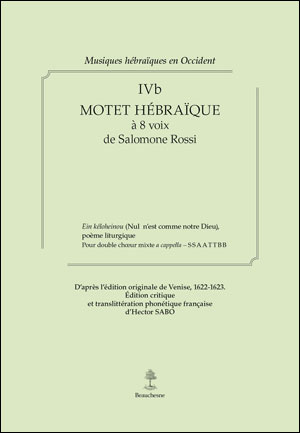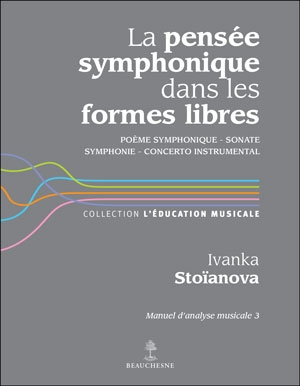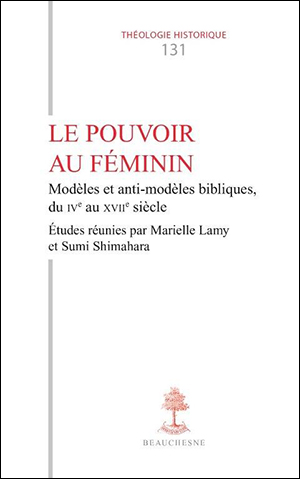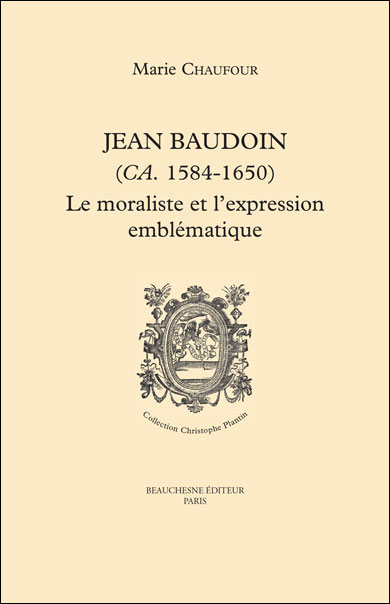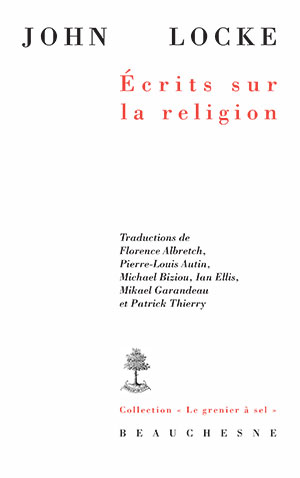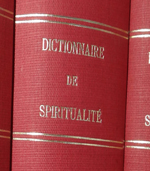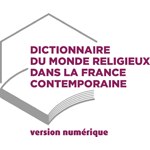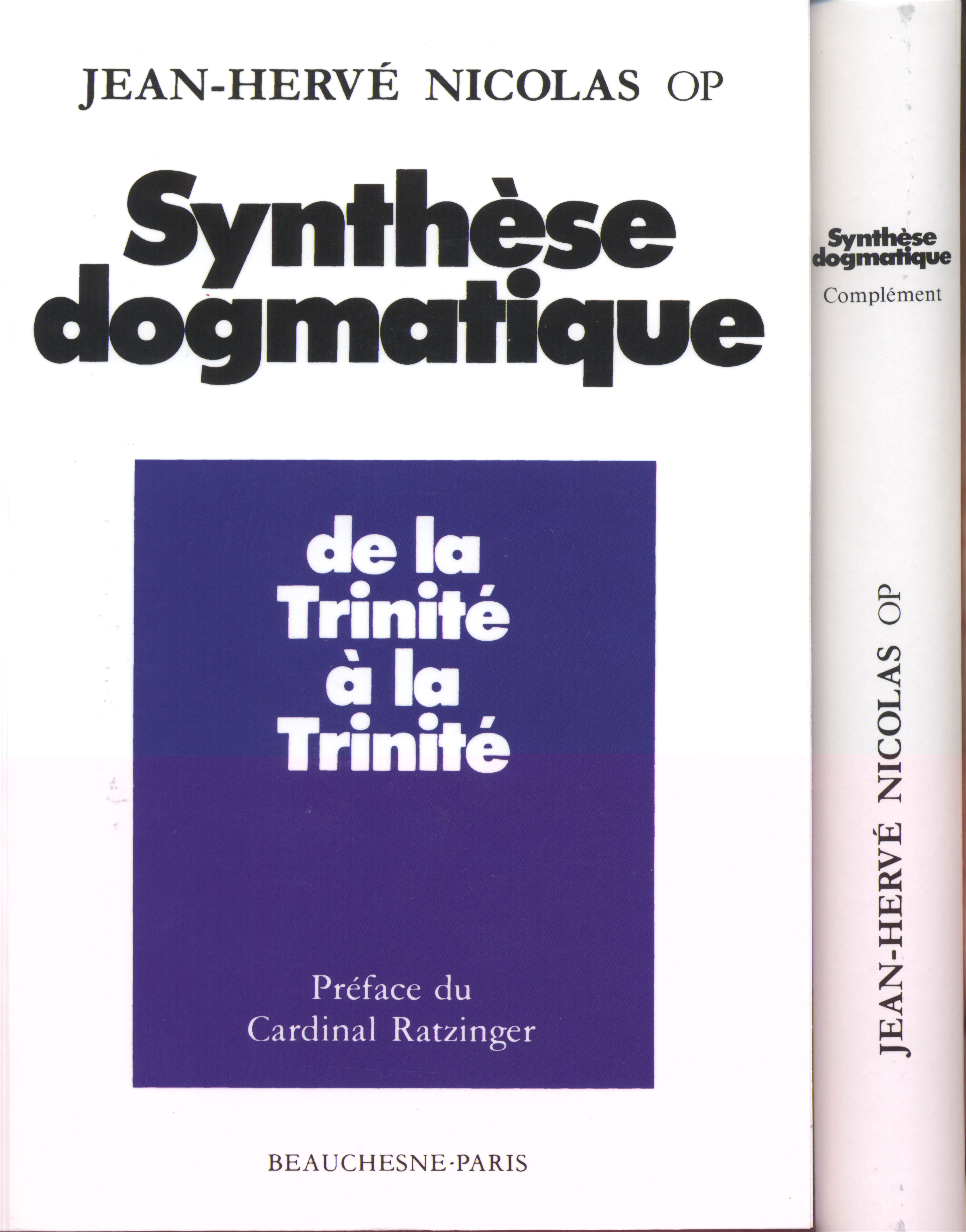40.50 €
TH n°020 SOPHRONE DE JÉRUSALEM. VIE MONASTIQUE ET CONFESSION DOGMATIQUE
Date d'ajout : mardi 13 juin 2017
par G. C.
COLLECTANEA CISTERCIENSIA, 1973, 3
« Une hirondelle ne fait pas le printemps » et il est peut être trop tôt pour saluer dans cette belle thèse un renouveau de la théologie positive au service de la vie spirituelle. Si deux hirondelles sont plus convaincantes, n'hésitons pas à lui adjoindre l'étude dont le compte-rendu suit (n° 675), qui s'inspire d'un projet analogue pour aborder une autre personnalité monastique du même milieu et de la même époque. Ce projet commun s'applique, en réaction déclarée contre l'historicisme, à chercher la clef de la théorie dogmatique ou ascétique de l'auteur étudié dans sa praxis vécue. Pour un auteur comme Sophrone qui n'a pas à son actif d'œuvres proprement ascétiques (bien qu'il ait contribué à l'élaboration du Pré spirituel de son maître Jean Moschus), cette visée, plus exemplaire que dans le cas de Jean Climaque, n'est-elle pas trop ambitieuse ? Ne court-elle pas le risque de chercher à justifier à tout prix un postulat a priori ? Lu avec cette réticence, le dernier chapitre (« la divinisation par synergie ») fera peut-être, aux esprits chagrins, l'effet d'une fausse fenêtre pour la symétrie. On ne contestera pas que, dans la pensée de Sophrone, il y ait analogie réelle et presque symétrie entre l'union des deux natures dans le Christ et l'union des saints entre eux, avec nous et avec le Christ, entre la synergie qui divinise le chrétien et celle qui harmonise les deux volontés du Christ, entre l'incarnation de la volonté du Père dans le Christ et la vocation de ressemblance filiale du chrétien. Mais, peut-être, trouvera-t-on le butin trop maigre et les indices trop ténus pour justifier la thèse d'une théologie née de la contemplation et de la vie ascétique. Il y a trop peu, certes, pour une démonstration de raison, mais ne serait-ce pas trop demander à la raison ? Et le contenu de ce livre n'est-il pas offert pour être vécu, à son tour, comme un schéma de retraite, comme une question à poser sans cesse de la vie chrétienne d'aujourd'hui à celle dont témoigne l'œuvre de Sophrone ? C'est sa seule vérification possible. Sur l'histoire du monachisme palestinien et de ses luttes doctrinales comme sur celle de Sophrone, sur sa personne et sur son œuvre l'A. a constitué un dossier irréprochable du point de vue de l'objectivité scientifique. De même, son analyse de la théologie de Sophrone est d'abord d'une rigoureuse honnêteté. On ne s'engage donc pas à l'aventure dans une sorte de romantisme théologique, mais on ne se contente pas non plus de préciser des formulations. On en cherche les motivations à leur source : dans le cœur croyant du moine-évêque. Et là, l'exemple de Sophrone est bien choisi. Car, si on a connu parfois la tentation de l'utilitarisme spirituel chez les moines (par exemple, dans le cas de l'origénisme, rejeté un peu sommairement parce qu' « il tarit les larmes »), nous avons ici un théologien trop spirituel pour « faire la théologie pour elle-même » (1'art pour l'art !) et trop théologien pour la mettre au service d'une technique, aussi spirituelles que puissent être ses intentions. Il y a peut-être lieu de critiquer chez son interprète une tendance à survaloriser le poids de certains termes (la parrhèsia a bien rarement une valeur positive de relation à Dieu dans la littérature monastique et on a peine à croire que l'anachorèse ait la pluralité de sens que l'A. lui prête). Ceux qui ont à initier à la théologie trouveront dans ce livre l'apparat de rigueur : des notes, une bibliographie, des index, des annexes, mais ils trouveront bien plus une méthode. On peut souhaiter qu'elle soit mise à l'épreuve et développée.
« Une hirondelle ne fait pas le printemps » et il est peut être trop tôt pour saluer dans cette belle thèse un renouveau de la théologie positive au service de la vie spirituelle. Si deux hirondelles sont plus convaincantes, n'hésitons pas à lui adjoindre l'étude dont le compte-rendu suit (n° 675), qui s'inspire d'un projet analogue pour aborder une autre personnalité monastique du même milieu et de la même époque. Ce projet commun s'applique, en réaction déclarée contre l'historicisme, à chercher la clef de la théorie dogmatique ou ascétique de l'auteur étudié dans sa praxis vécue. Pour un auteur comme Sophrone qui n'a pas à son actif d'œuvres proprement ascétiques (bien qu'il ait contribué à l'élaboration du Pré spirituel de son maître Jean Moschus), cette visée, plus exemplaire que dans le cas de Jean Climaque, n'est-elle pas trop ambitieuse ? Ne court-elle pas le risque de chercher à justifier à tout prix un postulat a priori ? Lu avec cette réticence, le dernier chapitre (« la divinisation par synergie ») fera peut-être, aux esprits chagrins, l'effet d'une fausse fenêtre pour la symétrie. On ne contestera pas que, dans la pensée de Sophrone, il y ait analogie réelle et presque symétrie entre l'union des deux natures dans le Christ et l'union des saints entre eux, avec nous et avec le Christ, entre la synergie qui divinise le chrétien et celle qui harmonise les deux volontés du Christ, entre l'incarnation de la volonté du Père dans le Christ et la vocation de ressemblance filiale du chrétien. Mais, peut-être, trouvera-t-on le butin trop maigre et les indices trop ténus pour justifier la thèse d'une théologie née de la contemplation et de la vie ascétique. Il y a trop peu, certes, pour une démonstration de raison, mais ne serait-ce pas trop demander à la raison ? Et le contenu de ce livre n'est-il pas offert pour être vécu, à son tour, comme un schéma de retraite, comme une question à poser sans cesse de la vie chrétienne d'aujourd'hui à celle dont témoigne l'œuvre de Sophrone ? C'est sa seule vérification possible. Sur l'histoire du monachisme palestinien et de ses luttes doctrinales comme sur celle de Sophrone, sur sa personne et sur son œuvre l'A. a constitué un dossier irréprochable du point de vue de l'objectivité scientifique. De même, son analyse de la théologie de Sophrone est d'abord d'une rigoureuse honnêteté. On ne s'engage donc pas à l'aventure dans une sorte de romantisme théologique, mais on ne se contente pas non plus de préciser des formulations. On en cherche les motivations à leur source : dans le cœur croyant du moine-évêque. Et là, l'exemple de Sophrone est bien choisi. Car, si on a connu parfois la tentation de l'utilitarisme spirituel chez les moines (par exemple, dans le cas de l'origénisme, rejeté un peu sommairement parce qu' « il tarit les larmes »), nous avons ici un théologien trop spirituel pour « faire la théologie pour elle-même » (1'art pour l'art !) et trop théologien pour la mettre au service d'une technique, aussi spirituelles que puissent être ses intentions. Il y a peut-être lieu de critiquer chez son interprète une tendance à survaloriser le poids de certains termes (la parrhèsia a bien rarement une valeur positive de relation à Dieu dans la littérature monastique et on a peine à croire que l'anachorèse ait la pluralité de sens que l'A. lui prête). Ceux qui ont à initier à la théologie trouveront dans ce livre l'apparat de rigueur : des notes, une bibliographie, des index, des annexes, mais ils trouveront bien plus une méthode. On peut souhaiter qu'elle soit mise à l'épreuve et développée.
Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com
Le moteur peut rechercher dans différents champs :
- Un nom d’auteur (AUTEUR)
- Un mot du titre (TITRE)
- Un ISBN
- Un mot du texte de présentation (TEXTE)
- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).
La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.
En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.
Search engine www.editions-beauchesne.com
The engine can search in different fields:
- An author's name (AUTEUR)
- A word from the title (TITRE)
- An ISBN
- A word from the presentation text (TEXTE)
- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).
The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.
Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.